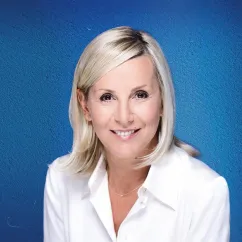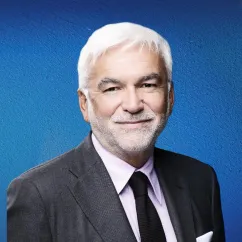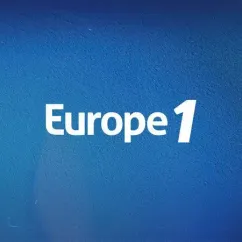En Iran, l'impact économique des mesures de Donald Trump envers la république islamique se font sentir de plein fouet, alors que la société continue de protester.
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet, Gwendoline Debono remplace Sophie Larmoyer à la présentation du Journal du monde.
Aujourd’hui, on part en Iran, où tous les voyants économiques sont au rouge.
Oui, la crise économique s’aggrave, la monnaie nationale a perdu 50% de sa valeur face au dollar en neuf mois, le prix des aliments de base lui grimpe, les loyers à Téhéran s’envolent, des dizaines de commerces ferment… La situation est telle que les deux tiers du parlement iranien ont demandé au président Hassan Rohani de remanier totalement son équipe économique.
C’est une conséquence directe de la politique de Donald Trump à l’égard de l’Iran.
Oui, parce que Donald Trump met une pression maximale sur Téhéran. Rappelez-vous en mai dernier, non seulement les États-Unis sont sortis de l’accord sur le nucléaire, mais le président américain a également annoncé de nouvelles sanctions. Le dernier exemple c’est le pétrole. Les États-Unis ont donné quatre mois à tous les pays pour arrêter d’acheter le brut iranien sous peine d’être sanctionnés à leur tour. Selon l’agence Reuters, l’Inde, le plus gros acheteur de pétrole iranien, cherche un plan B pour s’approvisionner. Or, le pétrole, c’est la première source de revenu de l’Iran.
C’est ce que le régime iranien appelle la guerre économique.
Oui, c’est en tout cas l’argument du président Rohani qui est en difficulté, il appelle les Iraniens à rester unis, il parle d’une inquiétude crée par des médias ennemis. Le problème c’est que si l’opinion iranienne ne supporte pas les appels de Trump à changer le régime, elle ne supporte pas non plus de voir ses conditions de vie de plus en plus dégradées.
Et d’ailleurs, on se souvient des mouvements de protestations en début d’année en Iran, qui continuent.
Oui, la semaine dernière les commerçants du bazar de Téhéran, le poumon économique du pays, se sont mis en grève. Des professeurs ont fait de même, comme des chauffeurs routiers, dans le sud il y a eu des affrontements à cause de la mauvaise gestion de l’eau. On parle d’un mouvement très différent du mouvement vert en 2009, jeune, plutôt éduqué. Aujourd’hui ce sont les classes moyennes basses qui protestent, c’est-à-dire bien souvent la base du régime. Et malgré les menaces, l’appareil sécuritaire ne semble pas en mesure d’arrêter ces mouvements de colère qui ne cessent d’éclore un peu partout en Iran.
On part maintenant au Japon avec Bernard Delattre, où les autorités essayent de s'attaquer à un problème social majeur : le surmenage, la surcharge de travail qui pèse sur les employés. Une nouvelle loi fixe un plafond maximal aux heures supplémentaires que l'on peut exiger des employés.
Oui, c'est une première. Elle vise à lutter contre le Karoshi. C'est un terme japonais qui signifie la mort due à un excès de travail. Chaque année, 200 à 300 Japonais meurent d'avoir trop travaillé ! Ils sont victimes d'un accident grave de santé qui survient au bureau (un infarctus, un AVC, etc.). Ou alors, ils se suicident tellement ils sont surmenés. La nouvelle loi changera-t-elle cela ? Ce n'est pas sûr, en fait. Car le plafond maximal d'heures supplémentaires autorisées a été fixé… à 100 par mois !
Cela revient à 3 ou 4 heures supplémentaires par jour, c'est énorme.
Oui, d'autant que beaucoup de Japonais travaillent déjà 10, 12 voire 15 heures par jour. Donc, en fait, beaucoup d'entreprises prennent elles-mêmes des mesures pour réduire les cas de Karoshi, qui nuisent beaucoup à leur image. 40% des PME ont établi un plan de prévention. Certaines, par exemple, utilisent des drones qui, le soir, survolent le personnel en le filmant, et repèrent les employés qui sont en train de dépasser le quota d'heures supplémentaires autorisé. Un SMS leur est immédiatement envoyé, les priant de rentrer chez eux.
D'autres mesures sont prises pour éviter que les Japonais continuent à se tuer au travail ?
Oui. Ici, on commence à accorder des primes aux employés… qui ne font pas d'heures supplémentaires. Ou on leur impose un temps minimum de repos entre deux journées de travail. Les badges d'entrée refusent l'accès au bureau des salariés qui l'ont quitté moins de 6 heures plus tôt. Ou alors, entre 22 heures et 6 heures du matin, toutes les lumières de l'entreprise s'éteignent automatiquement. Et les téléphones ainsi que les ordinateurs sont coupés. On en arrive même à remettre en cause ce qui a toujours été une tradition, au Japon : l'obligation, après la journée de travail, d'aller au bistrot pendant des heures avec les collègues et le chef de service. Ces sorties arrosées n'ont plus d'office lieu tous les soirs, comme auparavant.
En bref, l’Australie s’attaque au porte-monnaie des parents pour faire vacciner les enfants.
Oui, le programme est clair : pas de piqûre, pas d’argent. Si des parents refusent de faire vacciner leurs enfants hé bien une partie de leurs avantages fiscaux seront retirés. Si tous les vaccins ne sont pas à jours, les familles toucheront environ 600 euros de moins par an.