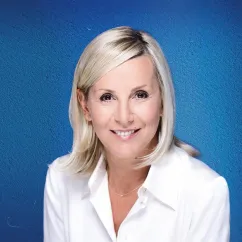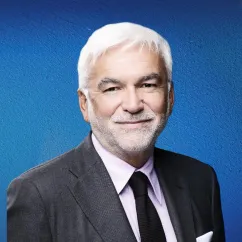Depuis lundi, la 4G est disponible dans l'ensemble du métro. Les yeux rivés sur leurs téléphones, les voyageurs d'aujourd'hui n'ont donc plus grand chose à voir avec ceux qui utilisaient la première ligne du métro parisien, il y a 120 ans. A l'époque, elle reliait la porte Maillot à la porte de Vincennes. Polémiques, défi technique… Dans ce nouvel épisode de "Au cœur de l'histoire", produit par Europe 1 Studio, Jean des Cars vous raconte l'histoire de ce chemin de fer urbain et électrique.
Le 19 juillet 1900, Paris inaugure sa première ligne de chemin de fer métropolitain. La capitale française était très en retard. Le métro avait été inauguré à Londres en 1863, sous le règne de Victoria et à Budapest en 1896. Dans ce nouvel épisode de "Au cœur de l'histoire" , produit par Europe 1 Studio, Jean des Cars vous raconte l'histoire d'un chantier pas comme les autres : celui du métro parisien.
Le métropolitain est la nouvelle merveille de l’Exposition Universelle de 1900 qui attire plus de 50 millions de visiteurs malgré la canicule. En ce jour inaugural du 19 juillet, le thermomètre indique 38°C à l’ombre ! Les tunnels du "métro", comme on l’appelle déjà, sont un endroit idéal pour se rafraîchir. Les premiers voyageurs sont curieux de découvrir le résultat de trois ans de travaux gigantesques. On n’avait pas vu cela depuis ceux du préfet Haussmann pour transformer Paris selon la volonté de Napoléon III.
En 1897, les adversaires de ce moyen de transport souterrain s’alarmaient, un peu comme ceux redoutant le chemin de fer il y a 60 ans. Cette-fois, on craint des pneumonies à cause des suintements d’eau dans les tunnels et des électrocutions à cause du mode de traction. Toutefois, Louis Barthou, alors ministre des travaux publics, avait classé le Métropolitain comme entreprise d’intérêt local et confié les travaux à la Ville de Paris.
Initialement, la ligne devait être inaugurée cinq jours plus tôt, le 14 juillet. Mais le préfet de police, M. Lépine, craignant une grande manifestation, a fait retarder la date au 18. Une importante délégation, avec le ministre des travaux publics et le préfet de la Seine, est monté dans la première rame qui a roulé de la Porte Maillot à la Porte de Vincennes. Aujourd’hui, le public payant peut s’engouffrer dans le sous-sol de la capitale.
Une aventure digne des prédictions de Jules Verne. Elle est le résultat de la volonté d’un homme né en 1852 dans les Côtes du Nord, un ingénieur, ancien élève de Polytechnique et des Ponts et Chaussées. Il se nomme Fulgence Bienvenüe, avec un tréma sur le u... Très tôt, il se fait remarquer par ses qualités lors de la construction de lignes pour le réseau ferroviaire en Bretagne. Un accident du travail le prive de l’usage d’un de ses membres. En plaisantant, il dit : "J’ai été exproprié de mon bras gauche !"
Après bien d’autres, il est chargé des plans du Métropolitain et tient compte de leurs études. En 1896, il propose à la ville un nouveau projet, avec six lignes prévues. Plus de 2.000 terrassiers ont travaillé en équipes jour et nuit sur la première ligne, évacuant chaque jour 1.000 m3 de déblais. L’une des prouesses de Bienvenüe sera la station Opéra où viendront se croiser trois lignes. Il a fallu enfoncer un énorme caisson métallique à 22 mètres sous la chaussée et tenir compte d’une rivière et d’un lac sous l’Opéra de Charles Garnier. Une véritable poche d’eau rendant les travaux dangereux. Pendant longtemps, un énorme trou déshonora la place de l’Opéra.
A la différence des trains, le métro roule à droite
Les premiers amateurs vont partir de la station de la Porte Maillot. Elle vient d’ouvrir. En surface, c’est une sorte de parapluie retourné ou de libellule, dans le style 1900 de l’architecte Hector Guimard. On parlera du "Style Metro". Représentant de l’Art Nouveau, Guimard est l’architecte de ces accès qu’on appellera "les bouches de métro". Elles sont reconnaissables à leur décor floral et végétal, avec de longues tiges entrelacées en fonte, à dominante courbe et de couleur verte. Ainsi, les entrées et sorties du Métropolitain sont originales et reconnaissables. Dans le hall, il fait déjà plus frais et l’atmosphère a été parfumée d’une fragrance inconnue. On respire !
A 13 heures, les premiers billets sont achetés et oblitérés. Vendu à l’unité, le billet pèse moins d’un gramme et mesure 57 mm. Il est de couleur orange en première classe, vert et orange en seconde. Le nom de la station où il a été acheté est imprimé sur le billet. Le tarif est de 25 centimes en première, 15 en seconde. Les billets aller-retour ne sont possibles qu’en seconde classe et dans la même journée.
La voiture automotrice puise son courant électrique par un frotteur sur le troisième rail. Derrière, elle, la première rame de métro parisien est prête. Trois voitures sont à quai, deux de seconde classe aux sièges en bois vernis, propres et confortables, une de première classe aux banquettes rembourrées de cuir brun. Les voitures, dont la caisse est en bois verni, sont très bien éclairées par dix lampes électriques chacune. Chaque voiture peut accueillir trente voyageurs assis et une dizaine debout dans le couloir central.
La Compagnie de Métropolitain possède déjà 161 voitures et dès ce jour, elle peut mettre en circulation des rames se succédant à 5 minutes d’intervalle, voir à 2 minutes aux heures plus chargées. Dans chaque compartiment, un employé veille à la fermeture des portes. La vitesse moyenne est de 25/30 km/h mais peut atteindre les 40 km/h. Cette première ligne s’étend sur un peu plus de dix kilomètres. Les passagers sont surpris : à la différence des trains, le métro roule à droite, comme les tramways.
Ce 19 juillet, la rame brûle certaines stations, inachevées, 10 sur 18. Cette alternance d’obscurité et de lumière fascinent ces premiers voyageurs et voyageuses. Ils posent des questions. Ils apprennent, par exemple, que c’est la localisation géographique qui détermine le nom de la station : une rue, une place, un boulevard... En une demi-heure, on traverse Paris d’Ouest en Est et on se retrouve Porte de Vincennes. "C’est prodigieux !" clament ces voyageurs qui n’oublieront jamais cette plongée dans le sous-sol, fiers comme des pionniers.
Contrairement aux menaces des pessimistes, aucun tunnel ne s’est effondré, aucun voyageur n’a été asphyxié. Les dames chapeautées et portant voilette sont rassurées : il n’y a eu aucun geste déplacé de la part d’un goujat... Du moins, personne ne s’en est plaint !
De violentes polémiques
Ces premiers clients du Métro parisien en oublient les polémiques qui avaient violemment divisé les politiciens de tous bords, les Parisiens, les entrepreneurs, les ingénieurs, les ouvriers, les habitants de tous âges et de toutes conditions. Partisans et adversaires s’étaient affrontés depuis une vingtaine d’années. Les uns craignaient que les immeubles et les maisons ne s’effondrent à cause des travaux dans le sous-sol. C’était arrivé pendant les travaux d’Haussmann. On connaissait des témoins survivants de ces catastrophes...
Les autres assurent que les souterrains ne sont que des cloaques, chargés de miasmes. Cette atmosphère fétide sera responsable d’épidémies. Et on veut pour preuve que les premières ouvertures creusées dans le sol ont fait fuir des colonies de rats ! Les uns prédisent que le Métro répandra la peste, les autres que l’atmosphère sera irrespirable. Et quand on apprend qu’un rail supplémentaire sera chargé d’électricité, un jeu de mot macabre circule : "Le Métropolitain deviendra le nécropolitain !".
A la Chambre des Députés, un parlementaire, en plein délire, s’était même écrié : "Le métro est antinational, antimunicipal, antiptariotique ! Il est attentatoire à la gloire de Paris !". Des médecins craignent que le public ne soit trop près des égouts. Des ecclésiastiques supplient qu’on épargne les catacombes. Cet ossuaire municipal est dans un labyrinthe de galeries, très présentes surtout dans le 14ème arrondissement.
En revanche, les gens de bon sens imaginaient les services que le Métropolitain pourra rendre aux Parisiens et aux gens résidant en banlieue. Des économistes voient même dans ce projet un remède aux difficultés de la vie et aux embarras de la circulation avec un constat qui, 120 ans plus tard, est plus que jamais d’actualité.
Ecoutons l’un d’eux : "Le Métro, en rapprochant les distances, égalisera les conditions de la concurrence. Il produira rapidement un abaissement général des loyers. N’est-il pas non plus évident, que grâce aux transports en commun souterrains, tous les problèmes de l’embouteillage des rues seraient définitivement réglés dans la capitale ?"
De gigantesques obstacles techniques
Dans les années 1880-1890, des ingénieurs discutent encore sur l’idée d’un chemin de fer aérien qui, selon eux, serait plus pratique que la solution souterraine. Le réseau suivrait le cours de la Seine. Projets et contre-projets s’affrontent. Cependant, les amoureux de Paris s’indignent à l’idée de voir un jour leur ville défigurée par de nombreux viaducs. Une commission est fondée à laquelle participa, quelques mois avant sa mort en 1885, Victor Hugo. Elle doit veiller sur l’esthétique de la capitale.
Les partisans du Métro aérien continuent à proposer leurs solutions, dont, en 1891, un inventeur qui imaginait une quadruple voie ferrée aérienne à six mètres au-dessus des ponts sur la Seine.
Mais pendant ce temps, l’ingénieur Berlier a repris le projet souterrain. Le Conseil Municipal, lui, lutte contre les prétentions de certaines compagnies privées de chemins de fer qui cherchent le moyen de prolonger leurs lignes à l’intérieur de la capitale. Le conflit prend fin en 1895 : la Ville de Paris aura sa compagnie de Métro pour exploiter, dès que possible, six lignes sur un total de 65 kilomètres.
La mise en service de cette première ligne ne peut faire oublier les gigantesques obstacles techniques qu’il a fallu surmonter, comme, par exemple, dans la zone de l’avenue Gambetta où des sables infiltrés d’eau ont dû être asséchés tandis qu’on redoutait l’effondrement d’anciennes carrières. Ou aussi qu’il a fallu mettre provisoirement à sec le canal Saint-Martin pour édifier un tunnel placé à cinq mètres au-dessous du fond de son lit ! Un incroyable exploit !
Ou encore les déblais nécessaires à l’aménagement de la station Concorde qui représentent, en volume, une colline de 70 mètres de haut qui occuperait la superficie de la place de la Concorde.
La Seine est un sérieux défi. Entre le Châtelet et le boulevard Saint-Michel, il faut franchir les deux bras du fleuve. Initialement Bienvenüe devait faire passer la ligne sous le palais de l'Institut, siège de cinq académies, dont l'Académie française. Les Immortels se sont plaints de ce crime de lèse-majesté. Bienvenüe a été obligé de changer ses plans ! Trois gigantesques caissons métalliques de 36, 38 et 43 mètres de long sur 9,60m de large et 9 m de haut sont prévus pour le grand bras du fleuve. Deux autres caissons de 20m de long serviront pour le petit bras de la Seine. Chacun de ces cinq appareils comporte ce qu’on appelle une "chambre de travail" de 1,80 m de haut.
Les trois premiers caissons qui doivent enrober les futurs tunnels, sont immergés en amont du Pont-au-Change, les deux autres en amont du Pont Saint-Michel puis, peu à peu, enfoncés à 15 mètres dans le fond de la Seine. On déplorera cinq morts au cours de ces longues et délicates opérations.
Les travaux ont révélé d’insoupçonnables trésors du passé parisien : on a mis à jour des couches géologiques mais aussi l’histoire de l’ancienne Lutèce avec des sarcophages, des barques, des bas-reliefs et même des... ossements de mammouths ! Encadrées par des ingénieurs, des missions archéologiques ont été organisées.
Le drame de Belleville
Mais déjà, Fulgence Bienvenüe travaille à une autre ligne qui traversera Paris avec les travaux de la Compagnie Nord-Sud. Elle reliera Montmartre à Montparnasse. Cette ligne, elle aussi, passera sous le lit de la Seine. Paris continue d’être un chantier permanent. Les cochers de fiacre, les actionnaires des compagnies de tramways à chevaux et les marchands de quatre saisons sont furieux : leur clientèle se fait rare...
À mesure que les ouvriers creusent, la tranchée est soutenue par des coffrages en planches. Puis, la voûte du tunnel est exécutée en maçonnerie. En décembre 1899, un effondrement se produit entre l’avenue de Friedland et les Champs-Elysées. La faille mesure 50 mètres de long sur 15 de large. La chaussée dégringole, entraînant des arbres et des becs de gaz. Deux passants sont blessés mais les terrassiers ont pu se mettre à l’abri.
Les polémiques reprennent, alimentées par la presse. Dans tel journal, on annonce que les voyageurs seront asphyxiés, dans un autre on est sûr que les pickpockets profiteront de l’obscurité. On ne prévoit que des calamités. Un journaliste décrit une des futures stations. Voici ce qu’il annonce : "Figurez-vous, après être descendu à quinze mètres par un escalier glissant, entre les murs humides et sales, arrivant sur un trottoir mouillé entre un mur et des piliers dont il ne faudrait pas s’approcher, recevant les suintements d’eau de la voûte, ne pouvant vous asseoir sur les bancs humides malgré l’entretien, entrant dans des wagons ruisselants... Il ne faudrait pas être en sueur car la mort vous attendrait à la station que vous auriez choisie pour but de votre course !"
Malgré ces sinistres prédictions, le Métropolitain sera plébiscité. Bien sûr, comme dans tous les moyens de transport, il y aura des accidents et des tragédies, dont le drame survenu le 10 août 1903, à la suite d’un incendie entre les stations Belleville et Couronnes. A cause d’une intoxication à l’oxyde de carbone, on déplorera 77 morts. Mais - et on l’a encore vérifié récemment -, la vie parisienne, quelle qu’elle soit, serait beaucoup plus difficile sans le Métro.
Il connaîtra plusieurs évolutions. La 1ère classe a été supprimée en 1991. Le réseau comprend aujourd’hui seize lignes, dont une automatique, la 14, lancée en 1998. Elle est la plus rapide, avec une vitesse moyenne de 40 km/h. L’ensemble totalise 220 kilomètres, 303 stations et ses lignes sont souvent connectées à d’autres moyens de transports en commun, comme le RER et le tramway. Les couloirs du Métro s’étendent sur 150km. La station la plus fréquentée est la Gare du Nord avec près de 50 millions de voyageurs par an.
Le nom de Bienvenüe, qui mourra en 1936, sera honoré par la station, alors rebaptisée Montparnasse-Bienvenüe mais beaucoup de gens croient qu’il s’agit d’une formule de politesse…
Vous voulez écouter les autres épisodes de ce podcast ?
>> Retrouvez-les sur notre site Europe1.fr et sur Apple Podcasts , SoundCloud , Dailymotion et YouTube , ou vos plateformes habituelles d’écoute.
>> Retrouvez ici le mode d'emploi pour écouter tous les podcasts d'Europe 1
"Au cœur de l'histoire" est un podcast Europe 1 Studio
Auteur et présentation : Jean des Cars
Cheffe de projet : Adèle Ponticelli
Réalisation : Laurent Sirguy et Guillaume Vasseau
Diffusion et édition : Clémence Olivier
Graphisme : Europe 1 Studio
Bibliographie : "Le Journal de la France", tome IX, sous la direction de Christian Melchior-Bonnet (Tallandier, 1978). "Chronique de Paris". Rédacteur en Chef : Jean des Cars (Editions Chronique, 2003).

![Marguerite d'Angoulême, la très sage soeur de François Ier [1/2]](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/324,324,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/square/public/media/image/2026/01/02/15/acdhe-vg.jpg?VersionId=utbTFrHoDGxUZxJkuPBFdQWHhN9gSKdl)

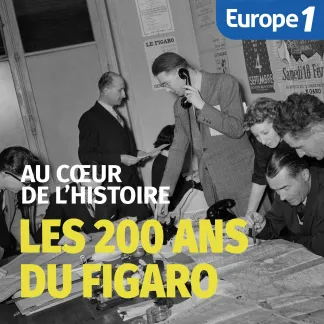


![L'enfant du Temple était-il vraiment Louis XVII ? [2/2]](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/324,324,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/square/public/media/image/2026/01/02/10/acdh_0.jpg?VersionId=da9toZfgy_YGp1wGiwh5B0fRxRamdbcK)
![L'enfant du Temple était-il vraiment Louis XVII ? [1/2]](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/324,324,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/square/public/media/image/2026/01/02/10/acdh.jpg?VersionId=JEQO6XmnL83rQqlZmWyG2vGTvCSKx7HU)
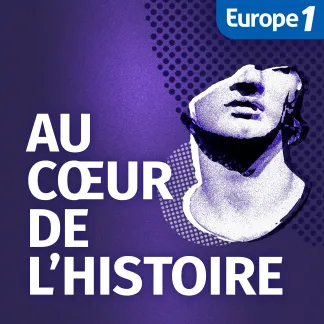

![Marco Polo, les voyages d'un explorateur vénitien [2/2]](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/324,324,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/square/public/media/image/2025/12/31/17/acdhe-vg.jpg?VersionId=N0V_eApk_wU0lab2lH7HXoTFZswVCttN)
![[1/2] Hergé, l'histoire en bulles](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/1-2-herge-l-histoire-en-bulles.jpg?VersionId=DjcpVDTZP0Sor.QSrFoms0qvS9Owrpej)

![[2/2] Diane de Poitiers, la dame d’Henri II](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/20/2-2-diane-de-poitiers-la-dame-d-henri-ii.jpg?VersionId=ElNAWoQOQB70SP4_VBo5awHZfs8ZDWWz)
![[1/2] Diane de Poitiers, la dame d’Henri II](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/1-2-diane-de-poitiers-la-dame-d-henri-ii.jpg?VersionId=ke.MF.CXoLuEj.XIQ2Khv7ag67BrAUXj)
![[4/4] Sartre et Beauvoir, exister ensemble](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/4-4-sartre-et-beauvoir-exister-ensemble.jpg?VersionId=UgTRpogjsB.JEpouTVuqv6h4LrfjS7Eb)
![[3/4] Sartre et Beauvoir, exister ensemble](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/3-4-sartre-et-beauvoir-exister-ensemble.jpg?VersionId=3q1myCeyS3F.fs34KOXLfJvxpgliIBM7)