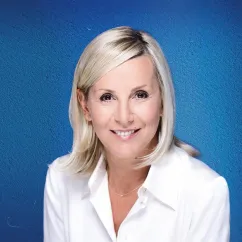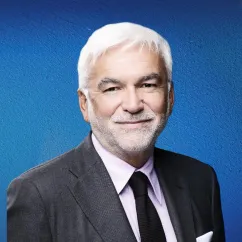C'est une française qui règne sur la baie de New-York depuis 134 ans… Dans ce nouvel épisode du podcast Europe 1 Studio "Au cœur de l'Histoire", Jean des Cars revient sur les origines de la statue de la Liberté, le plus célèbre des symboles de l’amitié franco-américaine.
En 1885, les pièces détachées d'une étrange géante de fer quittent la Plaine Monceau pour rejoindre New-York par la mer. Dans ce nouvel épisode du podcast Europe 1 Studio "Au cœur de l'histoire" , Jean des Cars vous raconte comment l'un des symboles incontournables des Etats-Unis a été pensé et fabriqué en France pour célébrer l'amitié entre les deux pays.
Drôle de spectacle près du parc Monceau
Nous sommes à Paris, au début de 1884. Les habitants du quartier de la Plaine Monceau sont très intrigués par un chantier spectaculaire. Près du boulevard de Courcelles, au numéro 25 de l’étroite rue de Chazelles, la fonderie Gaget et Gauthier est spécialisée dans l’édification et la restauration de monuments. Onze ans plus tôt, en 1873, on y avait remis en état la colonne Vendôme, abattue par la Commune en 1871.
Cette-fois, le chantier est beaucoup plus intrigant. Et on observe une noria de chariots transportant des moules de terre glaise venus d’un atelier de l’avenue d’Orléans, aujourd’hui l’avenue du Général Leclerc. A travers un gigantesque échafaudage, les passants s’arrêtent, curieux de découvrir, dominant les toits, la statue d’une femme drapée dans un voile, le bras droit levé tenant un flambeau.
La dernière statue d’une femme érigée dans Paris avait été inaugurée deux ans plus tôt, le 14 juillet 1884 : il s’agissait du monument dédié à la République. Une immense statue de femme, sculptée par Léopold Morice, trônait désormais sur l’ancienne place du Château d’eau devenue place de la République. Vêtue d’une toge à l’antique et coiffée d’un bonnet phrygien, elle tient dans sa main droite un rameau d’olivier. Dans l’autre, les tables de la Loi et un fragment de la Déclaration des Droits de l’ Homme.
On s’interroge sur le chantier de la rue de Chazelles, devenu une curiosité : que représente donc cette nouvelle gigantesque sculpture féminine, haute de 33 mètres mais atteignant les 67 mètres avec son socle qui la font dépasser les immeubles haussmanniens ? Et où sera-t-elle installée ?
Il s’agit de commémorer, avec un peu de retard, un anniversaire historique et de marquer l’amitié franco-américaine. Les Etats-Unis, sortis de la tragique guerre de Sécession, veulent célébrer le centenaire de leur naissance officielle. La date est difficile à choisir : il y a d’abord le 4 juillet 1774 : c’est l’acte fondateur de la déclaration d’indépendance par le Congrès. Il y a ensuite le 6 février 1778, jour où la France reconnaît officiellement les Etats-Unis indépendants, et s’allie à eux dans la guerre qui les oppose à l’Angleterre. Puis il y a la bataille de Yorktown le 19 octobre 1781. L’armée des Insurgents, grâce au soutien décisif de Rochambeau, de La Fayette et de l’amiral de Grasse, est victorieuse des Anglais qui capitulent. La quatrième et dernière date possible est le traité de paix signé le 3 septembre 1783 à Versailles et à Paris, par lequel l’Angleterre reconnait, elle-aussi, l’indépendance des Etats-Unis.
Le choix est compliqué mais une chose est claire : sans la France, les treize provinces révoltées contre l’Angleterre seraient peut-être encore des colonies britanniques.
La statue sera installée aux États Unis en 1886. On peut donc imaginer qu’elle commémore le centenaire du traité de 1783 - avec 3 ans de retard cependant.
Mais après tout, les Etats-Unis avaient mis presque dix ans à être reconnus. Ce décalage sera compensé par la réalisation d’une œuvre aussi spectaculaire qu’originale, un magnifique cadeau que la France veut offrir aux Etats-Unis en témoignage d’amitié. Un symbole à la fois unique au monde et universel. Parmi les curieux qui viennent contempler la statue en chantier, un certain Victor Hugo dira : "La mer, cette grande agitée, constate l’union de deux terres apaisées."
C’est le résultat du travail d’un audacieux duo : Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel.
Les papas de Miss Liberty
Frédéric Auguste Bartholdi est un sculpteur d’origine alsacienne, né à Colmar en 1834. Son premier succès fut la statue du général Rapp, également né à Colmar et défenseur de Strasbourg pendant les Cent-Jours. Ayant reçu de nombreuses commandes officielles, il exprime des sentiments patriotiques dans un style marqué par la tradition académique. Il est ainsi l’auteur du célèbre Lion de Belfort, sculpté dans le roc, dont une version réduite, en bronze, fut érigée en 1880 à Paris, place Denfert-Rochereau, à la gloire des défenseurs de Belfort en 1870 et de leur chef, le colonel Denfert-Rochereau.
Bartholdi est donc un artiste reconnu et le sculpteur de cette nouvelle statue qui émerge de l’atelier de la rue de Chazelles. On l’appellera "La Liberté éclairant le monde". La liberté était évidemment l’enjeu de la guerre d’indépendance et la Lumière est celle du siècle qui a éclairé aussi les pères fondateurs de la Constitution américaine.
La structure interne de la statue doit être très solide pour résister à tous les vents et à tous les effets des courants puisqu’elle prendra place sur une île, au large de New-York, au sud de Manhattan, à l’embouchure de l’Hudson. Pour des millions d’immigrants, la statue de la Liberté, à un kilomètre de Ellis Island, sera le symbole d’une nouvelle terre promise en espérant y être accueillis après d’interminables - et souvent humiliants - interrogatoires et contrôles. La statue de la Liberté et l'île de l’immigration se défieront longtemps.
En réalité, le projet de la statue remonte à 1870. Il était porté par un juriste et politicien français, Édouard Laboulaye, observateur attentif de la vie politique américaine. Il souhaitait que la France républicaine rappelle au monde que celle de Louis XVI était, en fait, la vraie marraine de l’indépendance des Etats-Unis d'Amérique et que ce soutien avait, à tous égards, coûté très cher à la monarchie…
Auguste Bartholdi est conscient que la structure interne de la statue doit être d’une résistance exceptionnelle. Il s’adresse donc à un homme qui a déjà fait ses preuves, le fascinant Gustave Eiffel, dont les équipes sont extraordinaires. Il devra concevoir une ossature métallique résistant aux vents de l’Atlantique.
Gustave Eiffel est un ingénieur français d’origine allemande, né à Dijon en 1832. Il a d’ailleurs failli travailler dans une usine fabricant de la moutarde ! Mais il se rend finalement à Paris, où il échoue à l’oral de Polytechnique, mais est reçu à l’Ecole Centrale. Il est passionné d’aérodynamique et souhaite que la technique soit au service du progrès humain.
En 1858, il dirige le chantier du pont métallique de Bordeaux, destiné à raccorder deux importants réseaux ferroviaires, celui de la Compagnie du Paris-Orléans et celui de la Compagnie du Midi. A 26 ans, il est à la tête d’un ouvrage considérable et agit en véritable patron. Pendant les travaux, Gustave Eiffel sauve un ouvrier de la noyade en plongeant dans la Garonne. Ses collègues, reconnaissants, lui offrent une médaille en souvenir de son courage. Eiffel est très sensible à la qualité des relations avec le monde ouvrier.
En 1877, à Levallois, qui est encore un village à la frontière du Paris de Napoléon III et deviendra une cité industrielle, il crée une société de construction métallique. Il est associé à Théophile Seyrig, un jeune ingénieur fortuné de l’Ecole Centrale. Eiffel devient réputé dans la construction de ponts et viaducs. Celui de Garabit, dans le Cantal, franchit la Truyère à 122m de haut. Cette hauteur correspond à l’élévation de Notre-Dame de Paris à laquelle on superposerait la colonne de la Bastille !
Le métal est le domaine d’Eiffel. La variété des applications qu’il en fait est étonnante : de la synagogue de la rue des Tournelles dans le quartier du Marais au lycée Carnot dans le XVIIe arrondissement, en passant par la charpente du magasin "Au Bon Marché" au carrefour Sèvres-Babylone, Eiffel impose la suprématie métallique.
Sa réputation finit par dépasser les frontières. En 1875, l’Empire Austro-Hongrois lui confie la construction de la gare de Budapest, achevée en deux ans. C’est l’une des toutes premières associations du métal et de la maçonnerie. Au Portugal, à Lisbonne, il construit le grand ascenseur qui reliera la ville basse à la ville haute et à Porto, un pont sur le Douro. Même Ferdinand de Lesseps demandera à Gustave Eiffel de prendre en main le chantier du percement de l’isthme de Panama. Et le tsar de Russie, Alexandre III, le consultera sur les itinéraires qu’empruntera le chemin de fer Transsibérien.
Le squelette métallique de la statue de la Liberté est calculé et dessiné par Maurice Koechlin, en 1881, un collaborateur de Gustave Eiffel, souvent oublié dans cette aventure. Bartholdi et Eiffel décident que la statue sera en cuivre repoussé. Trois cents plaques aux formes dessinées avec minutie seront scrupuleusement martelées puis rivetées entre elles, selon les instructions précises de Bartholdi et d’Eiffel.
Le squelette est une sorte d’échafaudage fixe. A l’intérieur du monument, il en assurera la stabilité. Quelles que soient les tempêtes, les orages, les ouragans, la Statue de la Liberté devra résister car la Liberté, même statufiée, ne peut s’écrouler… Son poids de 225 tonnes a été calculé en fonction de l’ile sur laquelle elle regardera le monde arrivant aux Etats-Unis ou en partant.
Bartholdi veut mettre en valeur la Liberté triomphante : son visage sera ceint d’une couronne. Le bras droit levé, elle tiendra une torche qui ne s’éteindra jamais. Cette lumière sera le symbole de l’étincelle politique à l’origine de l’indépendance aux Etats-Unis, en 1776, pour tous les voyageurs arrivant à New-York par voie maritime.
Le montage de la statue : un spectacle incroyable !
Il n’est pas question que la statue soit montée en France. Les pièces détachées vont traverser l’Atlantique. Avant le départ, tous ses éléments sont remis symboliquement à son excellence M. Norton, ambassadeur des Etats-Unis en France. Une plaque, offerte au diplomate, en conserve le souvenir en anglais. En voici la traduction : "Société Internationale et Historique d’ingénierie civile. Auguste Bartholdi dit merci à Monsieur Eiffel, avec reconnaissance, pour la Statue de la Liberté qui lui doit son squelette de fer."
Au printemps 1885, le navire de guerre français L’Isère part de Rouen avec 214 caisses contenant la précieuse cargaison. Mais l’argent manque pour le montage de la statue. Le philanthrope Pulitzer réveille alors l’amour-propre des Américains. Avec lui, les fonds arrivent, et Bartholdi est invité à New-York.
Ce cadeau de la France attire des foules de curieux. Le montage sera très long et spectaculaire, suivi attentivement par la presse mondiale. On voit des ouvriers, assis sur des sellettes suspendues par des cordes, fixant les plaques de cuivre. Comparés au colosse, ils ressemblent à des fourmis. Ils évoquent aussi l’image des lilliputiens essayant d’enchaîner le géant Gulliver. Ils finissent par le bras droit et la tête dont le squelette métallique offre une vision étrange…
La main droite de la Liberté s’élève à 110 mètres au-dessus du niveau de l’eau. L’inauguration est décidée pour le 23 octobre 1886 en présence du président Grover Cleveland. Sa carrière est une curiosité politique : ce Démocrate, qui fit face au triomphant Sénat républicain, est le seul président ayant été élu pour deux mandats non consécutifs, le premier de 1885 à 1889 et le second de 1893 à 1897.
Pour cette fête, décrété jour férié, le Congrès des Etats-Unis a voté un crédit spécial et lancé dix mille invitations. Mais une condition expresse doit être respectée : pas un dollar ne doit être utilisé pour l’achat de cigares ou d’alcool. La Liberté rimera avec la sobriété ! Mais, en réalité, on fera discrètement savoir aux invités qu’ils pourront fumer et se rafraîchir… Grâce à une initiative privée.
Après une grande parade civile et militaire à Madison Square, les officiels s’embarquent pour Bedloe’s Island. 300 navires escortent celui du Président Cleveland. La délégation française est conduite par Ferdinand de Lesseps. Auguste Bartholdi monte dans la statue par l’escalier intérieur. Il tire lui même sur la corde libérant le drapeau français qui voilait la tête auréolée. Les canons tonnent, accompagnés par les sirènes des bateaux. La force du monument sculpté par Bartholdi impressionne les contemporains. Un témoin dira : "La robuste et placide déesse romaine dans sa noble robe antique, flambeau en main, forme finale de la statue, a, dit-on, pris le visage de la propre mère de l’artiste, dont le calme et la forte personnalité correspondaient à l’expression d’une liberté solide et sage."
Cette statue est alors, par sa structure, la plus grande jamais édifiée dans le monde… Elle est certainement aussi la plus connue. Et, vous allez le voir, cette renommée lui a permis d’avoir plusieurs vies…
Références bibliographiques :
André Kaspi, Les Américains (Seuil, 2002)
Frédéric Martel, De la culture en Amérique (Gallimard, 2006)
L’ILLUSTRATION : Les Grands Dossiers, à l’initiative d’Eric Baschet (Le Livre de Paris, 1987)
Vous voulez écouter les autres épisodes de ce podcast ?
>> Retrouvez-les sur notre site Europe1.fr et sur Apple Podcasts , SoundCloud , Dailymotion et YouTube , ou vos plateformes habituelles d’écoute.
>> Retrouvez ici le mode d'emploi pour écouter tous les podcasts d'Europe 1
"Au cœur de l'histoire" est un podcast Europe 1 Studio
Auteur et présentation : Jean des Cars
Production : Timothée Magot
Réalisation : Jean-François Bussière
Diffusion et édition : Clémence Olivier
Graphisme : Karelle Villais


![Marguerite d'Angoulême, la très sage soeur de François Ier [1/2]](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/324,324,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/square/public/media/image/2026/01/02/15/acdhe-vg.jpg?VersionId=utbTFrHoDGxUZxJkuPBFdQWHhN9gSKdl)

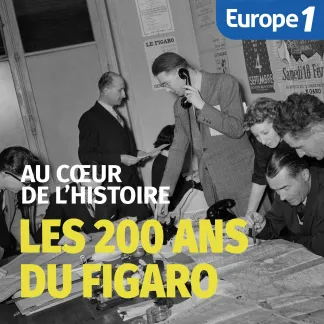


![L'enfant du Temple était-il vraiment Louis XVII ? [2/2]](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/324,324,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/square/public/media/image/2026/01/02/10/acdh_0.jpg?VersionId=da9toZfgy_YGp1wGiwh5B0fRxRamdbcK)
![L'enfant du Temple était-il vraiment Louis XVII ? [1/2]](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/324,324,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/square/public/media/image/2026/01/02/10/acdh.jpg?VersionId=JEQO6XmnL83rQqlZmWyG2vGTvCSKx7HU)
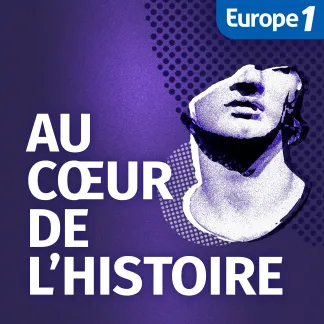

![[1/2] Hergé, l'histoire en bulles](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/1-2-herge-l-histoire-en-bulles.jpg?VersionId=DjcpVDTZP0Sor.QSrFoms0qvS9Owrpej)

![[2/2] Diane de Poitiers, la dame d’Henri II](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/20/2-2-diane-de-poitiers-la-dame-d-henri-ii.jpg?VersionId=ElNAWoQOQB70SP4_VBo5awHZfs8ZDWWz)
![[1/2] Diane de Poitiers, la dame d’Henri II](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/1-2-diane-de-poitiers-la-dame-d-henri-ii.jpg?VersionId=ke.MF.CXoLuEj.XIQ2Khv7ag67BrAUXj)
![[4/4] Sartre et Beauvoir, exister ensemble](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/4-4-sartre-et-beauvoir-exister-ensemble.jpg?VersionId=UgTRpogjsB.JEpouTVuqv6h4LrfjS7Eb)
![[3/4] Sartre et Beauvoir, exister ensemble](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/3-4-sartre-et-beauvoir-exister-ensemble.jpg?VersionId=3q1myCeyS3F.fs34KOXLfJvxpgliIBM7)