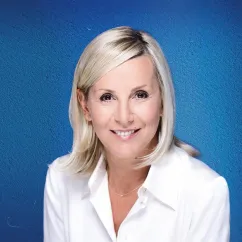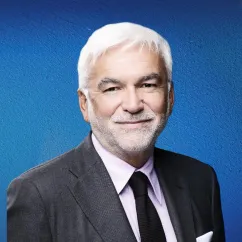Florence Nightingale a permis au métier d'infirmière de devenir honorable, indispensable et gratifiant. C'est pourquoi les pays du monde entier célèbrent les femmes et les hommes qui exercent cette profession le 12 mai, jour de sa naissance. Dans ce nouvel épisode de "Au cœur de l'histoire", produit par Europe 1 Studio, Jean des Cars revient sur le parcours de cette pionnière des soins infirmiers modernes, une héroïne de la guerre de Crimée qui sera reçue et honorée par la reine Victoria.
Avec les médecins et les aides soignantes, les infirmiers et infirmières font partis des professions en première ligne pour soigner les malades du Coronavirus. C'est pourquoi, à l'occasion de la journée internationale des Infirmières, il nous est apparu important de rendre honneur à la femme qui a donné ses lettres de noblesse aux soins infirmiers : l'Anglaise Florence Nightingale. Dans ce nouvel épisode de "Au cœur de l'histoire" , produit par Europe 1 Studio, Jean des Cars dresse le portrait de la pionnière des soins infirmiers modernes.
Le 5 octobre 1856, dans son manoir écossais de Balmoral, la reine Victoria reçoit l’infirmière Florence Nightingale, l’héroïne féminine de la guerre de Crimée. À son propos, quelques jours auparavant, la souveraine avait écrit : "Je l’envie d’être à même de faire tant de bien et de soigner les nobles et courageux héros dont la conduite est admirable". Florence Nightingale était revenue de Constantinople au mois d’août, quatre mois après la signature du traité de paix au Congrès de Paris, le 30 mars 1856. Elle avait veillé aux soins et au rapatriement de tous les blessés de son hôpital. Elle était épuisée et malade. C’est une convalescente que Victoria accueille dans sa résidence privée favorite.
La reine s’était beaucoup intéressée au sort des soldats de la guerre de Crimée, qui a opposé de 1854 à 1856 l’Empire russe à une coalition composée du Royaume-Uni, de la France, de l’Empire Ottoman et du royaume de Sardaigne. Elle se sentait responsable de chacun d’eux. Avant de se rendre à Balmoral, elle avait visité nombre de blessés dans les hôpitaux de Londres. Elle avait invité, au Palais de Buckingham, les convalescents capables de marcher. Elle avait passé les troupes en revue et remis des décorations.
Arrivée à Balmoral, Victoria avait réalisé un album de photographies représentant les combattants qui s’étaient le plus distingués dans la bataille, avec des renseignements sur chacun. La souveraine s’empresse de montrer cet album à Florence Nightingale.
-"La Reine demande : "Combien de rondes faisiez-vous chaque nuit à l’hôpital ?"
-"Trois" répond Florence, car il y avait 2.000 patients".
-La Reine : "Mais alors, quand dormiez-vous ?"
-Florence : "Oh...Ce premier hiver, nous n’avions pas l’impression d’avoir besoin de beaucoup dormir."
En effet, Florence s’était rendue célèbre en Angleterre. On l’appelait "la dame à la lampe" car c’est ainsi qu’elle visitait les blessés la nuit, pour les réconforter. Mais qui est donc Florence Nightingale, cette femme qui s’est tellement illustrée en Crimée que la Reine se fait un devoir de la recevoir pour l’en remercier ?
La naissance d'une vocation
Florence Nightingale est née le 12 mai 1820, dans la Villa Colombia, à Florence. Ses parents, William Edward et Frances Nightingale, sont un couple anglais fortuné. Ils sont en Europe pour leur voyage de noces. Leur première fille est née un an plus tôt à Naples ; son prénom est Parthénope, l’ancien nom grec de Naples. Chacune de leurs filles porte donc un prénom associé à son lieu de naissance, en Italie.
A son retour en Angleterre fin 1820, la famille Nightingale partage son temps entre deux maisons : l’été dans le Derbyshire, en hiver à Hembley, dans le Hampshire. Les deux sœurs sont éduquées par leurs parents. Ils leur apprennent le français, l’allemand, l’italien, le latin, le grec, l’histoire et la philosophie. Florence est studieuse. Très vite, elle est sensible aux conditions de la vie des populations défavorisées. Sa famille est très religieuse. Elle finance les soins médicaux des habitants pauvres de la région.
Durant l’hiver 1838, une épidémie de grippe frappe la région de Hembley. Florence est épargnée et soigne toute sa famille. Cet épisode est capital. La jeune fille a une sorte de révélation. Elle écrit dans son journal : "Dieu m’a parlé et m’a appelé à son service". L’année suivante, en 1839, un cousin, qui séjourne dans la famille, l’initie aux mathématiques. Elle est passionnée et obtient d’avoir un professeur dans cette discipline. Elle s’intéresse particulièrement aux statistiques. En dehors de ses études, Florence, qui est très jolie, participe à la vie mondaine et sociale. Elle aime les réceptions, les bals et la danse. Elle rencontre des gens très intéressants comme Charles Darwin, le naturaliste inventeur de la théorie de l’évolution et Ada Lovelace, mathématicienne, une pionnière de la future informatique.
Ses parents refusent qu'elle fasse des études d'infirmière
Florence fait aussi la connaissance d’un médecin américain, Samuel Gridley Howel. Elle lui fait part de son désir de devenir infirmière mais elle craint que ce ne soit pas un métier convenable pour une jeune femme de son milieu. Il l’encourage à suivre sa vocation. Consciente que les hospices britanniques sont délaissés, que les malades y meurent souvent par défaut de soins, elle souhaite s’engager pour améliorer cette terrible situation. En 1845, elle exprime à ses parents sa volonté de suivre une formation d’infirmière. Elle a 25 ans et n’est pas encore mariée et tient à améliorer ses connaissances.
Ses parents refusent obstinément qu’elle fasse des études d’infirmière. À cette époque, les soins des malades dans les hôpitaux sont assurés par des religieuses ou par femmes pauvres et sans instruction. C’est un statut peu enviable. Pour lui changer les idées, ses parents décident que Florence va voyager en Europe, avec des amis de la famille, Charles et Selina Bretbridge. Le trio va parcourir l'Italie, l'Egypte et la Grèce. Sur le chemin du retour, en 1850, ils passent par les Etats allemands.
Ils rendent visite au pasteur Theodor Fliedner. Celui-ci dirige un hôpital et une école pour infirmières à Kaiserwerth, près de Düsseldorf. Florence est séduite. Elle a 30 ans. Cette-fois, ses parents capitulent. Un an plus tard, elle y revient pour suivre, pendant trois mois, une formation de soignante. La jeune femme va y apprendre à soigner les blessures, à préparer les médicaments et à s’occuper des patients. Cette expérience la conforte dans sa vocation. Elle va la compléter à Paris. En 1853, on lui propose le poste de surintendante d’un institut où l’on soigne des femmes de bon milieu mais de faibles revenus.
L’institution charitable siège à Londres au 1, Harley Street. Tout le monde sait que Harley Street est la rue des médecins. Elle y acquiert rapidement une excellente réputation. Parallèlement, elle compile des statistiques. Elle démontre que dans les hôpitaux de Londres, le taux de mortalité est supérieur à celui des malades mourant à domicile. Elle va devenir infirmière chef à l’hôpital du King’s College, à Londres, lorsqu’éclate la guerre de Crimée.
La guerre de Crimée
Ce conflit va opposer, je vous l’ai dit, la Grande-Bretagne et la France, qui défendent l’Empire Ottoman, à la Russie. Les raisons de cette guerre sont multiples. La première est la "Question d’Orient", à savoir le devenir des possessions turques en Europe, alors que l’Empire ottoman est en pleine déliquescence. Les causes directes du conflit sont au nombre de trois : d’abord, l’ambition de la Russie d’avoir, pour sa flotte de la mer Noire, un accès aux détroits et donc à la Méditerranée. La deuxième est la détermination de l’Angleterre de maintenir sa domination en Méditerranée et donc d’empêcher les Russes d’accéder aux détroits.
La troisième est un différend entre la France et la Russie pour la protection des lieux saints. Une querelle entre catholiques et orthodoxes. Bethléem et Jérusalem sont en territoire ottoman. Les moines orthodoxes se sentent discriminés face à l’expansion catholique sur les lieux saints. En mars 1853, le tsar Nicolas 1er envoie un émissaire à Constantinople pour manifester son mécontentement. Il réclame la protection du clergé orthodoxe en Turquie. Agacé, le Sultan rejette cette demande. Le tsar riposte dès juillet 1853 : il occupe militairement les principautés danubiennes de Moldavie et de Valachie, dans l’actuelle Roumanie.
En prévision de ce coup de force, la France et la Grande-Bretagne avaient déjà envoyé deux escadres à l’entrée des Dardanelles. La Turquie, offensée de l’occupation de ses territoires par la Russie, déclare seule la guerre à la Russie le 4 octobre 1853. En représailles, le 30 novembre, une escadre russe détruit la flotte turque à Sinope, en mer Noire. Tous les navires sont coulés. Cette fois, la guerre est inévitable. Les escadres franco-anglaises quittent les Dardanelles. Elles font route vers le nord, à travers la mer Noire. C’est dans la presqu'île de Crimée que les hostilités se dérouleront. Le principal enjeu est Sébastopol, le port de guerre russe sur la mer Noire. Les Anglais déclarent que "Sébastopol est la canine de l’ours qu’il allait falloir extraire". L’ours russe, bien entendu...
Officiellement, la guerre est déclarée le 27 mars 1854. L’étonnant rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne est le résultat de la très fine diplomatie de Napoléon III : Victoria et son mari Albert sont totalement séduits par la personnalité de l’Empereur des Français et le charme de l’Impératrice Eugénie. Cet état de grâce a été concrétisé par deux visites d'Etat. La première, celle du couple français à Londres, fut suivie de la visite de Victoria et du prince Albert à Paris.
L’armée française est commandée par le maréchal de Saint-Arnaud, les troupes anglaises par lord Raglan. Ce dernier avait perdu un bras à Waterloo. Son ingénieux tailleur lui avait inventé un manteau dont les manches partent du col et se prolongent jusqu’aux poignets. Cela permet de camoufler l’infirmité du commandant en chef. La manche Raglan a considérablement contribué à la notoriété de ce soldat !
Une première victoire des zouaves français sur les Russes est remportée le 20 septembre 1854 sur les berges d’un petit fleuve, l’Alma. Mais la route vers Sébastopol est longue et dangereuse. Il y a de nombreux malades de fièvres et de dysenterie parmi les Anglais. Le Cabinet britannique est obligé de faire appel à une souscription populaire pour acheter des médicaments. En fait, les conditions sanitaires des troupes anglaises sont déplorables, moins bonnes que celles des Français. Même le Times critique vivement les soins apportés aux blessés.
Florence Nightingale chargée d'organiser l'arrivée d'infirmières en Turquie
C’est alors que le ministre de la guerre, Sidney Herbert, qui connaissait Florence Nightingale et son travail à Harley Street, la charge d’organiser l’arrivée d’infirmières britanniques en Turquie. Florence recrute le service de 37 nurses, accompagnées de plusieurs chaperons. Le groupe de femmes débarque le 4 novembre 1854 à Constantinople. Il s’installe dans une caserne transformée en hôpital, le Barracks Hospital, à Scutari, un quartier de Constantinople, sur la côte asiatique. Ce Scutari ne doit pas être confondu avec le port albanais de Scutari, en mer Adriatique.
En arrivant, Florence découvre une situation sanitaire catastrophique. Le personnel est débordé, les blessés négligés. Beaucoup viennent d’arriver après la terrible bataille de Balaklava. Une victoire britannique payée au prix du sang, des centaines de morts et de nombreux blessés. Ils ont été transportés en bateau depuis jusqu’à Scutari. Ce transbordement a été une épreuve supplémentaire pour les soldats.
Il y a de nombreuses infections, dues au manque d’hygiène. Les logements sont infestés de rats et de puces. Les rations d’eau quotidiennes sont limitées à un demi-litre par personne. Et les médecins militaires n’apprécient pas ce bataillon de femmes, pourtant si efficaces.
Mais il en faut plus pour décourager Florence ! Avec ses infirmières, elle nettoie de fond en comble l’hôpital. Elle aère les salles et laisse entrer le soleil. Elle réorganise les soins. Il était temps que Florence arrive : la meurtrière bataille d’Inkerman amène un flot de nouveaux blessés dont il faut s’occuper d’urgence. Non seulement Miss Nightingale est, comme ses infirmières, bienveillante à leur égard mais elle écrit des lettres de la part des soldats à leurs familles, elle se charge de leur faire verser leurs soldes, elle organise des salles de lectures. Elle gagne ainsi l’estime de tous les soldats britanniques. Mais le pire est encore à venir ! L’hiver est épouvantable, froid et humide. Outre les blessures, il faut soigner les gelures et faire face à des épidémies de typhus et de choléra.
Le retour de l'héroïne
En janvier 1856, la reine Victoria est informée de l’admirable travail effectué par Florence Nightingale et ses infirmières. La Reine lui écrit : "Chère Miss Nightingale, vous êtes instruite, je le sais, de la haute estime que m’inspire le dévouement chrétien que vous avez montré durant cette grande et sanglante guerre, et j’ai à peine besoin de vous redire la profondeur de mon admiration pour vos services qui ne le cèdent pas à ceux de mes chers et braves soldats, dont vous avez eu le privilège d’alléger les souffrances avec tant de pitié... Ce sera pour moi une très grande satisfaction, quand vous reviendrez enfin sur nos rivages, de faire la connaissance d’une personne qui a donné un tel exemple à notre sexe". La Reine fait preuve de beaucoup d’intelligence dans cette lettre et de liberté d’esprit. Sa vision de Florence Nightingale, dans sa promotion du métier d’infirmière, est profondément féministe.
Victoria tiendra sa promesse en accueillant l’infirmière à Balmoral, comme je vous l’ai raconté au début de ce récit. A son retour, Florence Nightingale est reçue comme une héroïne. Mais elle va continuer à travailler dans la discrétion. A la demande de la Reine, en novembre 1856, elle participe à la "Commission Royale pour la Santé, chargée de l’amélioration de l’état sanitaire dans l’Armée britannique". Elle rédige un rapport de plus de 1.000 pages sur ses observations à l’hôpital de Scutari. Elle inclut des statistiques détaillées. Ce qui lui vaut d’être élue, en 1860, la première femme membre de la Société Statistique. Elle s’installe ensuite à Londres, dans le quartier de Mayfair en 1865. Elle y résidera jusqu’à sa mort.
Sa plus grande réussite sera sans doute d’avoir fait de la fonction d’infirmière une profession respectable pour les femmes. En 1860, elle va pouvoir concrétiser son rêve. Grâce aux fonds récoltés par la souscription de reconnaissance à son égard, elle crée sa propre école d’infirmières qui deviendra un modèle du genre. C’est la "Nightingale School and Home for nurses at St. Thomas Hospital". Les stagiaires y reçoivent, pendant une année, une formation qui inclut des cours magistraux mais surtout le travail pratique en salles, sous la surveillance d’une infirmière chevronnée. Une fois formées, les infirmières sont envoyées pour instruire le personnel de tous les hôpitaux de Grande-Bretagne. Certaines partent à l’étranger, pour ouvrir de nouvelles écoles sur le modèle londonien.
Le principe des soins codifiés
C’est à cette époque que Florence rédige son ouvrage le plus connu : "Notes on nursing". Elle y codifie le principe des soins. Ce livre a été traduit en onze langues et reste toujours d’actualité. Miss Nightingale sera aussi consultée lors de la guerre de Sécession aux États-Unis. Elle a également écrit sur la planification et l’organisation des hôpitaux. Elle a été la principale avocate du plan en pavillons séparés pour les hôpitaux britanniques. Elle était une farouche maniaque de la propreté et de l’hygiène ainsi que de la nécessité de la ventilation dans les salles d’hôpitaux. Tout le monde vient la consulter. En 1862, elle publie ses observations sur les problèmes sanitaires de l’Inde. En 1864, elle met au point un système de soins à domicile, de "maisons de naissance", d’hôpitaux pour les pauvres et pour les malades mentaux.
Mais Florence Nightingale est malade. Elle souffre de fibromyalgie, qui se traduit par une sensation de douleur générale diffuse, de brûlures de la tête aux pieds, avec un sentiment de fatigue profonde. A partir de 1896, elle ne peut plus se déplacer. Elle passe ses dernières années au lit, tout en continuant à travailler et à écrire.
En 1883, la reine Victoria lui a décernée la Royal Red Cross, la Croix-Rouge royale. Elle s’éteint le 13 août 1910, âgée de 90 ans, après avoir précisé qu’elle ne voulait pas de funérailles nationales à l’Abbaye de Westminster. Elle est enterrée dans le Hampshire, près de la maison de ses parents. Elle n’a jamais été mariée, on ne lui connaît pas d’aventures sentimentales. Elle a voué toute sa vie aux soins des malades, à l’amélioration de l’organisation des hôpitaux. Elle fait du statut d’infirmière un métier honorable, indispensable et gratifiant. Un musée lui est consacré à Londres, au St Thomas Hospital, où elle avait créé son école d’infirmières.
Vous voulez écouter les autres épisodes de ce podcast ?
>> Retrouvez-les sur notre site Europe1.fr et sur Apple Podcasts , SoundCloud , Dailymotion et YouTube , ou vos plateformes habituelles d’écoute.
>> Retrouvez ici le mode d'emploi pour écouter tous les podcasts d'Europe 1
"Au cœur de l'histoire" est un podcast Europe 1 Studio
Auteur et présentation : Jean des Cars
Cheffe de projet : Adèle Ponticelli
Réalisation : Guillaume Vasseau
Diffusion et édition : Clémence Olivier
Graphisme : Europe 1 Studio
Bibliographie : Emmeline Pankurst Suffragette, la genèse d’une militante ( Ampelos, 20919)

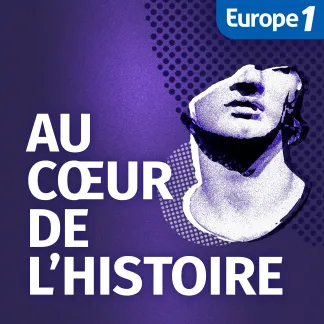

![Marco Polo, les voyages d'un explorateur vénitien [2/2]](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/324,324,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/square/public/media/image/2025/12/31/17/acdhe-vg.jpg?VersionId=N0V_eApk_wU0lab2lH7HXoTFZswVCttN)

![Marco Polo, les voyages d'un explorateur vénitien [1/2]](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/324,324,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/square/public/media/image/2025/12/31/16/acdhe-vg_0.jpg?VersionId=.RjEjfzmvKD.kPYXTjnW6psEYqcQPlwv)



![Anne d'Autriche, la mère du Roi Soleil [2/2]](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/324,324,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/square/public/media/image/2025/12/31/12/acdhe-vg.jpg?VersionId=j.iiyC_FxKbqQyj7dzgFQXCUh4llrKBA)

![[1/2] Hergé, l'histoire en bulles](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/1-2-herge-l-histoire-en-bulles.jpg?VersionId=DjcpVDTZP0Sor.QSrFoms0qvS9Owrpej)

![[2/2] Diane de Poitiers, la dame d’Henri II](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/20/2-2-diane-de-poitiers-la-dame-d-henri-ii.jpg?VersionId=ElNAWoQOQB70SP4_VBo5awHZfs8ZDWWz)
![[1/2] Diane de Poitiers, la dame d’Henri II](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/1-2-diane-de-poitiers-la-dame-d-henri-ii.jpg?VersionId=ke.MF.CXoLuEj.XIQ2Khv7ag67BrAUXj)
![[4/4] Sartre et Beauvoir, exister ensemble](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/4-4-sartre-et-beauvoir-exister-ensemble.jpg?VersionId=UgTRpogjsB.JEpouTVuqv6h4LrfjS7Eb)
![[3/4] Sartre et Beauvoir, exister ensemble](https://www.europe1.fr/lmnr/f/webp/rcrop/819,459,FFFFFF,center-middle/img/var/europe1/storage/styles/paysage/public/media/image/2024/11/18/19/3-4-sartre-et-beauvoir-exister-ensemble.jpg?VersionId=3q1myCeyS3F.fs34KOXLfJvxpgliIBM7)